Priorités en matière de climat et de politiques de santé au Canada – 2023
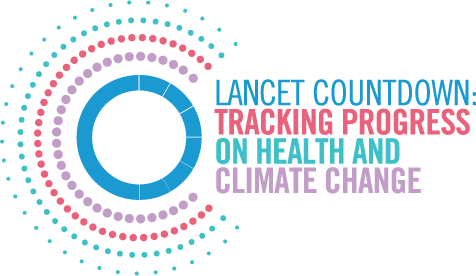
À l’été 2023, le Canada a connu sa pire saison de feux de forêt jamais enregistrée : plus de 18 millions d’hectares ont brûlé, causant des milliers d’évacuations et une fumée toxique qui a forcé les enfants et les personnes vulnérables à rester à l’intérieur1. Les phénomènes météorologiques extrêmes, exacerbés par les changements climatiques, menacent de plus en plus la santé de la population canadienne et les systèmes de santé. En parallèle, le système de santé national est mis à rude épreuve, et la forte augmentation du coût de la vie (qui comprend la hausse des prix des aliments) rend les pratiques favorisant la santé et l’adaptation aux changements climatiques de moins en moins accessibles.
Selon les évaluations actuelles du climat, la planète devrait se réchauffer d’en moyenne 3,2 °C d’ici la fin du siècle2. Les changements climatiques continueront d’avoir des effets dévastateurs sur la santé et la vie humaine en exerçant une pression encore plus forte sur les systèmes de santé et en empêchant toute possibilité d’adaptation, à moins que des mesures climatiques ambitieuses soient prises de toute urgence. De telles répercussions font ressortir l’importance de respecter les engagements prévus par l’Accord de Paris pour limiter le réchauffement mondial à 1,5 °C.
Le besoin de réduire les émissions n’a jamais été aussi urgent. Cette année, le compte rendu à l’intention du Canada se base sur les données les plus récentes du rapport de 2023 du Lancet Countdown3 pour expliquer la nécessité d’entamer une transition vers les énergies renouvelables et de mettre en œuvre des stratégies de promotion de la santé et d’adaptation aux changements climatiques relativement aux feux de forêt et aux systèmes alimentaires. Combinés à l’abandon impératif des combustibles fossiles au profit d’énergies renouvelables, la gestion des urgences en cas de feux de forêt et les systèmes alimentaires durables peuvent jouer un rôle essentiel dans l’amélioration de la santé de tous et de toutes, dans l’immédiat et à plus long terme.
Recommandations
Abandonner les investissements des combustibles fossiles et en cesser graduellement l’utilisation, investir massivement dans les énergies renouvelables et les infrastructures connexes et faire en sorte que tout le Canada puisse facilement accéder à des sources d’énergie durables.
Accroître la coordination intersectorielle et pangouvernementale de la gestion des urgences en cas de phénomènes météorologiques extrêmes. Allouer plus de ressources à la planification de l’adaptation, mettre en place des systèmes de soins de santé adaptés aux changements climatiques et veiller à l’intégration du savoir traditionnel dans les méthodes de prévention et d’intervention en cas de catastrophe.
Intégrer une optique de santé planétaire dans l’éducation et l’approvisionnement alimentaire du système de santé, de même que dans la production, la consommation et le gaspillage alimentaire à l’échelle de la société. Promouvoir une alimentation saine et durable qui se veut accessible, abordable et adaptée sur le plan culturel.
Effectuer la transition vers les énergies renouvelables et carboneutres
Si le gouvernement du Canada souhaite respecter son engagement à atteindre la carboneutralité d’ici 2050, il lui sera difficile d’y arriver sans s’employer davantage à accroître l’utilisation des énergies renouvelables et à abandonner graduellement les combustibles fossiles. L’accélération d’une transition énergétique juste permettra d’engendrer des avantages connexes pour la santé en favorisant un air plus propre, des réseaux de transport plus sains et un accès amélioré à l’énergie, ce qui bénéficiera à la santé de tous et de toutes au Canada.
Cette recommandation n’a rien de nouveau; les comptes rendus à l’intention du Canada de 2020 et de 2021 avaient aussi présenté plusieurs domaines dans lesquels le gouvernement et les acteurs non gouvernementaux pouvaient étoffer leurs objectifs en matière d’atténuation et assurer un avenir plus sain aux collectivités. Ces comptes rendus soulignaient la nécessité d’éliminer progressivement les subventions aux combustibles fossiles et de miser sur les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique, notamment dans le transport et le logement. Toutefois, comme le Canada continue d’accuser un retard dans la mise en œuvre de mesures d’atténuation ambitieuses, cette recommandation est toujours aussi pertinente et même plus urgente que jamais.
Les nouvelles données du rapport de 2023 du Lancet Countdown montrent que la part de l’offre énergétique totale formée par les sources d’énergie renouvelable n’a augmenté que de 0,3 % en 2020, comparativement à 2015. En 2020, les énergies renouvelables comptaient pour moins de 2 % de l’offre énergétique totale (indicateur 3.1.1). Dans l’industrie du transport en particulier, toujours en 2020, les combustibles fossiles représentaient encore 96 % de l’énergie utilisée en transport routier, générant d’énormes répercussions en matière d’exposition à la pollution atmosphérique, surtout dans les centres urbains. De ce fait, l’industrie du transport a été responsable de près de 1 000 décès prématurés en 2020 seulement. La transition vers des modes de transport électrique et collectif peut empêcher de tels décès, tout en évitant ou en réduisant les émissions de gaz à effet de serre. Toutefois, entre 2015 et 2020, le pourcentage d’énergie totale produite par l’électricité dans l’industrie du transport est resté stable, oscillant entre 0,2 % et 0,25 %.
Pour demeurer à l’avant-garde de la transition vers une filière énergétique et une économie saines et durables et accélérer la génération d’énergie à partir de sources renouvelables, le Canada doit aussi délaisser rapidement le recours aux combustibles fossiles. Pour ce faire, il doit limiter les flux financiers néfastes qui continuent de fournir du capital à l’industrie des combustibles fossiles et renforcent ainsi la production et l’utilisation de ces derniers. Les banques canadiennes, pour leur part, doivent réorienter le financement des combustibles fossiles vers les énergies renouvelables propres et l’efficacité énergétique pour favoriser une transition saine et juste vers la carboneutralité. Toutefois, si l’on compare les prêts offerts à l’industrie des combustibles fossiles dans les six années précédant l’entrée en vigueur de l’Accord de Paris (2010-2016) et dans les quatre années suivantes (2017-2021), quatre banques canadiennes font partie des 10 principales banques ayant le plus augmenté leurs investissements dans les combustibles fossiles (Financière Banque Nationale inc., BMO Marchés des capitaux, Banque Scotia et Valeurs Mobilières TD) (indicateur 4.2.4). Des politiques gouvernementales rigoureuses peuvent décourager ces investissements en promouvant plutôt les prêts et les investissements visant le secteur des énergies renouvelables et l’efficacité énergétique.
Le gouvernement doit agir en abandonnant rapidement ses investissements des combustibles fossiles et en en cessant graduellement l’utilisation, en investissant massivement dans les énergies renouvelables et les infrastructures connexes et en faisant en sorte que tout le Canada puisse facilement accéder à des sources d’énergie durables.
Recommandation no 1
Abandonner les investissements des combustibles fossiles et en cesser graduellement l’utilisation, investir massivement dans les énergies renouvelables et les infrastructures connexes et faire en sorte que tout le Canada puisse facilement accéder à des sources d’énergie durables.
Mesures stratégiques pertinentes :
- Éliminer toutes les subventions directes et indirectes pour les combustibles fossiles.
- Réorienter ce soutien financier vers des infrastructures énergétiques saines et renouvelables en misant sur une transition juste qui soutient la main-d’œuvre et les collectivités ainsi que les programmes d’adaptation climatique et sanitaire.
- Faire en sorte que l’industrie des combustibles fossiles n’influence plus l’élaboration des politiques. Instaurer des réunions entre des personnes représentant le gouvernement fédéral et des groupes à but lucratif et non lucratif selon un rapport d’un pour un (et en publier les présentations et les comptes rendus), et mettre fin aux réunions sur les politiques publiques tenues à huis clos avec des personnes représentant l’industrie des combustibles fossiles.
- Soutenir davantage le logement durable, notamment en fournissant des subventions pour la conception ou la rénovation à faibles émissions de carbone de résidences privées et de bâtiments publics.
Santé et phénomènes météorologiques extrêmes : feux de forêt
Avec le réchauffement planétaire, les principales causes des feux de forêt s’intensifient. La probabilité d’éclairs s’accroît4, et les forêts s’assèchent en raison de la variation des précipitations5 tout en devenant moins résilientes aux espèces envahissantes6,7. Les pratiques humaines de gestion forestière (y compris l’extinction des feux de forêt, qui homogénéise les combustibles forestiers) et l’interdiction des pratiques culturelles traditionnelles contre les incendies ont accru les risques d’incendie lié aux combustibles et les risques d’incendie majeur8.
Compte tenu des saisons de feux de forêt sans précédent qu’a connues le Canada ces dernières années et des prévisions actuelles indiquant une hausse de leur fréquence dans les décennies à venir, il est plus qu’important de limiter les risques de feux de forêt.
Des données du rapport de 2023 du Lancet Countdown montrent que de 2018 à 2022, la population canadienne moyenne a été exposée plus de deux jours à un risque très élevé ou extrêmement élevé de feux de forêt, ce qui représente une hausse de 116 % par rapport à la période de référence historique de 2003 à 2007. Pour sa part, l’exposition individuelle à la fumée des feux de forêt a augmenté de 220 % au cours des deux périodes de référence (indicateur 1.2.1).
La pollution atmosphérique causée par la fumée des feux de forêt pose des risques immédiats pour la santé cardiovasculaire, respiratoire et métabolique des populations locales et peut aussi toucher les collectivités éloignées9-13. En outre, les effets à long terme de l’exposition aux feux de forêt ne sont pas encore complètement compris14,15. Les déplacements dus à une évacuation entraînent une grave détresse psychologique ainsi qu’un état de stress post-traumatique, la perte de moyens de subsistance et des retombées économiques connexes, et des dommages et une pression en ce qui concerne les infrastructures et les services essentiels, y compris les soins de santé12,16-18.
Les populations racisées, rurales, éloignées, autochtones et ayant un faible statut socioéconomique peuvent aussi courir un risque accru de problèmes de santé12. Les communautés des Premières Nations sont plus fréquemment évacuées que les autres et pendant plus longtemps, parfois pendant trois mois ou plus (évacuation à long terme)19.
Pour réduire les effets des feux de forêt sur la santé humaine, les interventions en santé publique doivent être cohérentes, et les communications des acteurs du gouvernement et des systèmes de santé doivent être claires et adaptées au contexte. Le public peut consulter la cote air santé sur le site Web du gouvernement du Canada, mais l’information présentée ne sert pas toujours à formuler des recommandations d’activités utiles pour les personnes à risque. De ce fait, la santé publique et les autorités sanitaires locales doivent fournir aux collectivités des conseils uniformes à ce sujet lorsqu’il y a un risque d’exposition à la fumée de feux de forêt.
Le Canada a adopté en 2015 le Cadre d’action de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe, qui fait état des progrès internationaux en matière de réduction et d’intervention liées aux catastrophes. La mise en œuvre du cadre se fait lentement, et son déploiement varie d’une région à l’autre selon la disponibilité des ressources. Pour protéger la population et la santé publique, il est toutefois essentiel d’appliquer à l’échelle provinciale ses principes qui misent sur la prévention tout en promouvant des interventions solides et équitables lors de catastrophes comme des feux de forêt. Le Cadre d’action de Sendai préconise aussi l’utilisation du savoir traditionnel dans la réduction des risques de catastrophe, un domaine dans lequel le patrimoine culturel autochtone est considéré comme un atout en matière de résilience21.
Dans le même ordre d’idées, la toute nouvelle Stratégie nationale d’adaptation du Canada explique comment la réduction des risques de catastrophe doit passer par une mobilisation et une collaboration multisectorielles (p. ex., de multiples ministères fédéraux) et souligne l’importance de se baser sur des politiques (p. ex., la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones) et des pratiques fondées sur les droits et l’équité (p. ex., l’Analyse comparative entre les sexes). Néanmoins, des ressources de mise en œuvre et de coordination locales de la Stratégie nationale d’adaptation devront être fournies. Dans le secteur de la santé, le Canada a participé à l’initiative de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) sur les systèmes de santé résilients face aux changements climatiques et à faible émission de carbone en 2021, mais tarde à en mettre en œuvre. Il faudra mettre sur pied des secrétariats nationaux et provinciaux ou territoriaux collaborant avec les gouvernements autochtones pour renforcer la résilience des systèmes de santé face aux changements climatiques.
Il est très important de noter que les mesures d’adaptation seules ne suffisent pas. L’adaptation à un monde touché par les feux de forêt ne répond pas au besoin d’atténuer les principales causes des changements climatiques. L’élimination progressive de l’utilisation des combustibles fossiles et la transition vers les énergies renouvelables sont urgentes et nécessaires pour prévenir une hausse des températures créant les conditions propices à des phénomènes météorologiques extrêmes plus graves et plus fréquents. Ces phénomènes, qui peuvent se produire simultanément ou en cascade, ont de lourdes conséquences sur les équipes d’intervention en cas d’urgence et les infrastructures de base comme les réseaux électriques et les chaînes d’approvisionnement, et exacerbent les iniquités en matière de santé.
Recommandation no 2
Accroître la coordination intersectorielle et pangouvernementale de la gestion des urgences en cas de phénomènes météorologiques extrêmes. Allouer plus de ressources à la planification de l’adaptation, mettre en place des systèmes de soins de santé adaptés aux changements climatiques et veiller à l’intégration du savoir traditionnel dans les méthodes de prévention et d’intervention en cas de catastrophe.
Mesures stratégiques pertinentes :
- Améliorer les systèmes d’intervention en cas d’urgence lors de phénomènes météorologiques extrêmes comme des feux de forêt, des inondations et des ouragans en adoptant une approche basée sur la résilience, le savoir traditionnel et la préparation, et faire participer les populations locales à l’élaboration de politiques d’intervention et de plans équitables d’évacuation.
- Abandonner la culture d’extinction des feux de forêt pour plutôt renforcer la résilience des écosystèmes forestiers, et intégrer l’intendance des Autochtones dans la gestion forestière (favoriser le brûlage dirigé, planter des forêts riches en biodiversité, garder les arbres anciens plus résistants au feu, planifier la gestion forestière en tenant compte des changements climatiques).
- Mettre sur pied des secrétariats nationaux et provinciaux ou territoriaux dotés des bonnes ressources et collaborant avec les gouvernements autochtones pour coordonner les responsabilités liées au système de santé selon la Stratégie nationale d’adaptation et mettre en œuvre l’initiative de l’OMS sur les systèmes de santé résilients face aux changements climatiques et à faible émission de carbone.
- Élaborer de meilleures pratiques de communication des risques associés aux indices de la qualité de l’air pour mieux informer le public et les établissements paragouvernementaux (p. ex., écoles et garderies).
- Assurer un déploiement adéquat de ressources en santé mentale et physique pour les populations touchées et les premières personnes d’intervention, selon les besoins des collectivités.
Systèmes alimentaires, agriculture et avantages connexes pour la santé
Nous avons une occasion en or d’agir au profit de l’environnement et de la santé de la population : opérer une transition vers une alimentation durable. La mauvaise alimentation est l’un des principaux facteurs de risque de maladie chronique au Canada, par exemple de maladie cardiovasculaire, de diabète de type 2, d’obésité et de certains cancers22,23. L’environnement et l’alimentation doivent être examinés ensemble, car l’agriculture est responsable de 10 % des émissions de gaz à effet de serre du Canada24,25. Une grande proportion de ces émissions est liée à la viande rouge produite industriellement et aux aliments transformés, qui ont aussi des effets néfastes sur la santé, lorsque consommés en trop grande quantité26. Ainsi, la transition vers une alimentation riche en végétaux et faible en émissions de carbone réduit les émissions et favorise la santé.
Dans un souci de santé publique, le guide alimentaire canadien de 2015 met l’accent sur les aliments riches en végétaux tout en réduisant l’importance des protéines animales et des produits laitiers. Ce choix concorde avec le Régime de santé planétaire (Planetary Health Diet ou PHD), un cadre élaboré par des spécialistes de renommée mondiale en matière d’alimentation et d’environnement pour la Commission EAT-Lancet27. La prochaine étape consisterait donc à mettre en œuvre le PHD et les recommandations du guide alimentaire. L’accès à des aliments abordables, nutritifs et adaptés sur le plan culturel (et à des régimes alimentaires traditionnels pour les groupes autochtones) doit être examiné pour éviter d’exacerber les iniquités en matière de santé, surtout dans un contexte d’inflation en hausse.
Des données du rapport de 2023 du Lancet Countdown montrent qu’en 2020, 30 000 décès ont été associés à une consommation insuffisante d’aliments nutritifs à base de végétaux. Les problèmes de santé liés à la consommation excessive de viande rouge et de produits laitiers au Canada ont été associés à 17 000 décès prématurés (indicateur 3.3.2).
Du côté des émissions, en 2020, la viande rouge et les produits laitiers comptaient toujours pour 60 % de toutes les émissions associées à la consommation de produits agricoles au Canada, et pour 48 % de toutes les émissions liées à la production agricole. Globalement, ces dernières ont augmenté de 11 % entre 2000 et 2020 (indicateur 3.3.1).
Pour que la planète continue d’être un espace de développement sûr pour l’humanité, le PHD recommande de garder la quantité d’émissions liées à la consommation juste au-dessous de 0,5 t éq. CO2 par personne. À l’heure actuelle, la quantité moyenne d’émissions liées à l’alimentation est de 1,25 t éq. CO2 par personne25. Au Canada, la consommation moyenne de viande rouge (environ 100 grammes par jour) et de produits laitiers (environ 500 grammes par jour) dépasse les recommandations du PHD (de 0 à 28 grammes de viande par jour et 250 grammes de produits laitiers par jour). Il existe donc un écart majeur entre les lignes directrices nationales compatibles avec le PHD et leur mise en œuvre.
En outre, les politiques en matière d’alimentation durable doivent favoriser l’équité. Les Canadiens et Canadiennes ayant un statut socioéconomique élevé ont une alimentation plus saine que les personnes de faible statut socioéconomique, et les recommandations nutritionnelles seules ne peuvent pas inciter les groupes défavorisés à changer leurs habitudes alimentaires28. En 2022, 18,4 % de la population des provinces vivait dans l’insécurité alimentaire29. Les enfants sont particulièrement touchés par la dénutrition et, comme mentionné plus haut, le Canada reste l’un des seuls pays industrialisés à ne pas s’être doté d’un programme national d’alimentation en milieu scolaire30. Les fruits et les légumes frais sont parfois trop coûteux, en particulier pour les familles à faible revenu et certaines collectivités rurales, éloignées et nordiques.
Pour les peuples autochtones, les changements climatiques compliquent l’accès aux sources de nourriture traditionnelle, causant ainsi de l’insécurité alimentaire (une situation exacerbée par les territoires brûlés lors de feux de forêt, surtout au nord du pays). De plus, la trop grande dépendance à l’égard des aliments importés nuit à l’abordabilité et à l’autonomie31. Le colonialisme, le racisme, la contamination découlant de l’extraction de ressources et les changements d’habitat dus à la variation des températures et des précipitations ont déformé les systèmes alimentaires de nombreux peuples autochtones ainsi que les liens traditionnels qu’ils entretiennent avec la terre32. Les aliments traditionnels sont nutritifs et bénéfiques pour la santé et favorisent l’activité physique et la souveraineté alimentaire33.
Les hôpitaux et les écoles devraient donner l’exemple. Les programmes d’achat massif visant la distribution de denrées alimentaires dans les établissements de santé et d’enseignement peuvent créer des marchés de production alimentaire locale adaptée aux changements climatiques. En outre, de tels programmes alimentaires peuvent promouvoir une alimentation saine et durable auprès des personnes ayant le plus besoin de soutien nutritionnel : les enfants et les personnes atteintes de problèmes de santé.
La communauté de pratique nationale Nourrir la santé, qui mise sur la production locale, les menus bons pour la planète et les modes d’alimentation autochtones, a récemment lancé au Canada – en collaboration avec l’Institut des ressources mondiales (World Resource Institute) – l’initiative Promesse d’une alimentation saine (Cool Food Pledge), un pacte dans le cadre duquel les hôpitaux s’engagent à réduire les émissions de gaz à effet de serre associées à la nourriture qu’ils servent de 25 % d’ici 2030, ce qui concorde avec les objectifs de l’Accord de Paris. Cinq des plus grandes organisations de santé (totalisant 16 établissements de santé participants) au pays participent à l’initiative jusqu’à présent, servant 13 millions de repas par année. D’autres organismes de santé locaux, régionaux et provinciaux ou territoriaux peuvent faire preuve de leadership en s’y inscrivant.
Malheureusement, près de 20 % (11,2 millions de tonnes) des aliments comestibles produits au Canada finissent en déchets alimentaires évitables, à diverses étapes de la chaîne alimentaire33. Au pays, ces déchets produisent des émissions annuelles de gaz à effet de serre équivalant à 56,5 Mt éq. CO2, ce qui représente 60 % de l’empreinte de carbone de l’industrie alimentaire33. Le Canada a lancé le Défi de réduction du gaspillage alimentaire pour soutenir les personnes faisant preuve d’innovation dans le domaine34, mais les efforts doivent être intensifiés et appliqués à l’échelle de l’industrie.
Recommandation no 3
Intégrer une optique de santé planétaire dans l’éducation et l’approvisionnement alimentaire du système de santé, de même que dans la production, la consommation et le gaspillage alimentaire à l’échelle de la société. Promouvoir une alimentation saine et durable qui se veut accessible, abordable et adaptée sur le plan culturel.
Mesures stratégiques pertinentes :
- Ajouter les données sur les émissions dans l’étiquetage nutritionnel à l’échelle du pays.
- Mettre sur pied des politiques, des processus et des programmes qui favorisent une production alimentaire organique et durable.
- Investir dans un accord volontaire entre le gouvernement et l’industrie sur les pertes et les déchets alimentaires pour réduire les émissions et les pertes financières découlant du gaspillage d’aliments comestibles.
- Encourager les hôpitaux à participer à l’initiative Promesse d’une alimentation saine (Cool Food Pledge). Intégrer les recommandations du PHD dans les cafétérias et les programmes alimentaires des établissements de soins de santé et d’enseignement.
- Augmenter le nombre de programmes de soutien nutritionnel offerts aux ménages à faible revenu en mettant l’accent sur l’alimentation à base de végétaux et les aliments peu transformés.
- Favoriser la souveraineté alimentaire des Autochtones et compenser les coûts de la collecte, de la production et de la distribution de nourriture dans les collectivités éloignées. Accroître l’accès aux aliments traditionnels.
Conclusion
L’adoption d’une perspective de santé dans la lutte contre les changements climatiques permet de générer des bienfaits à la fois pour l’environnement et la santé, notamment en incitant davantage à passer à l’action et en améliorant directement la vie et le bien-être de la population. En outre, pour réduire les répercussions des changements climatiques sur la santé, il est plus qu’important de commencer rapidement à éliminer de façon graduelle l’utilisation des combustibles fossiles et de réaliser une transition vers les énergies renouvelables. Il faut aussi repenser nos systèmes alimentaires ainsi que notre préparation et notre réponse aux événements climatiques, comme les feux de forêt, pour améliorer la santé de la population canadienne actuelle et future.
Organisations et remerciements
Le présent compte rendu a été rédigé par : Finola Hackett, M. D., CCMF, Claudel Pétrin-Desrosiers, M. D., CCMF, Maya R. Kalogirou. Ph. D, IA, et Chris G. Buse, Ph. D.
Il a été révisé par Courtney Howard, M. D., CCMF (MU), et Deborah McGregor, Ph. D. Laura Myers, Taylor Hodgins Musgrave, Ashley Chisholm et Sarah Lowden ont participé à la rédaction et à la révision du document au nom de l’AMC. Ian Culbert, directeur général de l’Association canadienne de santé publique (ACSP), a participé à la rédaction et à la révision du document au nom de cette dernière. Marina Romanello, Ph. D., Camile Oliveira, M. Ph., et Elise Digga, M. Sc., ont participé à la rédaction et à la révision du document au nom du Lancet Countdown.
Références
- Centre interservices des feux de forêt du Canada inc. CIFFC | Page d’accueil [En ligne]. [consulté la VOA le 16 octobre 2023].
- Groupe international d’experts sur l’évolution du climat (GIEC). Rapport de synthèse AR6 : Changement climatique 2023 – GIEC [En ligne]. [consulté la VOA le 16 octobre 2023].
- Romanello M., et coll. The 2023 report of the Lancet Countdown on health and climate change: the imperative for a health-centred response in a world facing irreversible harms. Lancet 2023; publié en ligne le 14 novembre.
- Romps D. M., et coll. Projected increase in lightning strikes in the United States due to global warming. Science. Le 14 novembre 2014; vol. 346, no 6211 : p. 851–854.
- Flannigan M.D., et coll. Fuel moisture sensitivity to temperature and precipitation: climate change implications. Climatic Change. Le 1er janvier 2016; vol. 134, no 1 : p. 59-71.
- Coops N.C., et coll. A thirty year, fine-scale, characterization of area burned in Canadian forests shows evidence of regionally increasing trends in the last decade. PLoS One. Le 22 mai 2018; vol. 13, no 5 : p. e0197218.
- Erni S., et coll. Exposure of the Canadian wildland–human interface and population to wildland fire, under current and future climate conditions. Can J For Res. Septembre 2021; vol. 51, no 9 : p. 1357-1367.
- Daniels L. Incendies de forêt : causes, conséquences et coexistence. Rapport sur l’état des montagnes. The Alpine Club of Canada. Mai 2019; vol. 2 : p. 4-13.
- Kondo M.C., et coll. Meta-analysis of heterogeneity in the effects of wildfire smoke exposure on respiratory health in North America. Int J Environ Res Public Health. Le 18 mars 2019; vol. 16, no 6 : p. 960.
- Matz C.J., et coll. Health impact analysis of PM2.5 from wildfire smoke in Canada (2013-2015, 2017-2018). Sci Total Environ. Le 10 juillet 2020; vol. 725 : no 138506.
- Hadley M.B., et coll. Protecting cardiovascular health from wildfire smoke. Circulation. Le 6 septembre2022; vol. 146, no 10 : p. :788-801.
- Reid C.E. et M.M. Maestas. Wildfire smoke exposure under climate change: impact on respiratory health of affected communities. Curr Opin Pulm Med. Mars 2019; vol. 25, no 2 : p. 179-187.
- Chen H., et coll. Cardiovascular health impacts of wildfire smoke exposure. Particle and Fibre Toxicology. Le 7 janvier 2021; vol. 18, no 1 : p.2.
- Grant E., J.D.Runkle. Long-term health effects of wildfire exposure: A scoping review. The Journal of Climate Change and Health. Le 1er mai 2022; vol. 6 : p. 100110.
- Korsiak J., et coll. Long-term exposure to wildfires and cancer incidence in Canada: a population-based observational cohort study. The Lancet Planetary Health. Le 1er mai 2022; vol. 6, no 5 : p. e400–e409.
- Amjad S., et coll. Wildfire exposure during pregnancy and the risk of adverse birth outcomes: A systematic review. Environnement Int. Novembre 2021; vol. 156 : p. 106644.
- Howard C., et coll. SOS! Summer of Smoke: a retrospective cohort study examining the cardiorespiratory impacts of a severe and prolonged wildfire season in Canada’s high subarctic. BMJ Open. Le 4 février 2021; vol. 11, no 2 : p. e037029.
- Rice M.B., et coll. Respiratory impacts of wildland fire smoke: future challenges and policy opportunities. An Official American Thoracic Society Workshop Report. Ann Am Thorac Soc. Juin 2021; vol. 18, no 6 : p. 921-930.
- Bureau de la vérificatrice générale du Canada. Rapport 8 – La gestion des urgences dans les communautés des Premières Nations – Services aux Autochtones Canada 2022. [En ligne]. [consulté la VOA le 16 octobre 2023].
- Instance permanente des Nations Unies sur les questions autochtones. Backgrounder - Traditional Knowledge. [En ligne].
- Bureau des Nations Unies pour la réduction des risques des catastrophes (UNDRR). Words into Action: Using Traditional and Indigenous Knowledges for Disaster Risk Reduction [En ligne]. [consulté le 16 octobre 2023].
- Springmann M., et coll. The healthiness and sustainability of national and global food based dietary guidelines: modelling study. BMJ. Le 15 juillet 2020; vol. 370 : m2322.
- Bacon S.L., et coll. Canada’s new Healthy Eating Strategy: Implications for health care professionals and a call to action. Can Pharm J (Ott). Le 10 mars 2019; vol. 152, no 3 : p. 151-157.
- Agriculture et Agroalimentaire Canada. Émissions de gaz à effet de serre et agriculture [En ligne]. 2012.
- Loken B. et F. DeClerck. Rebooting and Reimagining Healthy and Sustainable Food Systems in the G20. Forum EAT [En ligne]. [consulté le 16 octobre 2023].
- Bouvard V., et coll. Carcinogenicity of consumption of red and processed meat. Lancet Oncol. Décembre 2015; vol. 16, no 16 : p. 1599-1600.
- Agriculture et Agroalimentaire Canada. Le gouvernement du Canada lance le Défi de réduction du gaspillage alimentaire. 2020. [En ligne]. [consulté la VOA le 16 octobre 2023].
- Olstad D.L., C.N.R.C. Campbell et C.D. Raine. Diet quality in Canada: policy solutions for equity. CMAJ. Le 28 janvier 2019;vol. 191, no 4 : p. E100–E102.
- PROOF - Université de Toronto. 2023. New data on household food insecurity in 2022. [En ligne]. [consulté le 16 octobre 2023].
- Coalition pour une saine alimentation scolaire. Pourquoi les programmes d’alimentation scolaire sont-ils si importants? [En ligne]. [consulté la VOA le 16 octobre 2023].
- Centre de collaboration nationale de la santé autochtone (CNCIH). Climate Change and Indigenous Peoples’ Health in Canada. 2022. [En ligne].
- Shafiee M., et coll. Food security status of Indigenous Peoples in Canada according to the 4 pillars of food security: a scoping review. Adv Nutr. Le 22 décembre 2022; vol. 13, no 6 : p. 2537-2558.
- Commission EAT-Lancet. The Planetary Health Diet. [En ligne]. [consulté le 16 octobre 2023].
- Gooch M., et coll. The Avoidable Crisis of Food Waste : A Technical Report. Ontario (Canada) : Value Chain Management International Inc and Second Harvest. [En ligne].
